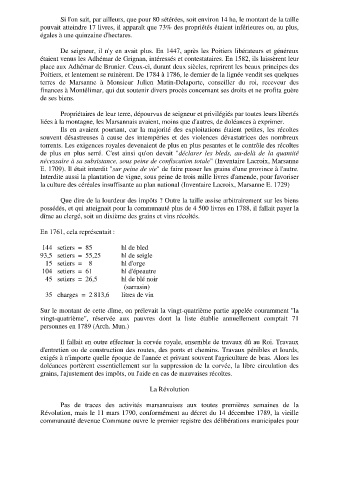Page 108 - Tous les bulletins de l'association des" Amis du Vieux Marsanne"
P. 108
Si l'on sait, par ailleurs, que pour 80 sétérées, soit environ 14 ha, le montant de la taille
pouvait atteindre 17 livres, il apparaît que 73% des propriétés étaient inférieures ou, au plus,
égales à une quinzaine d'hectares.
De seigneur, il n'y en avait plus. En 1447, après les Poitiers libérateurs et généreux
étaient venus les Adhémar de Grignan, intéressés et contestataires. En 1582, ils laissèrent leur
place aux Adhémar de Brunier. Ceux-ci, durant deux siècles, reprirent les beaux principes des
Poitiers, et lentement se ruinèrent. De 1784 à 1786, le dernier de la lignée vendit ses quelques
terres de Marsanne à Monsieur Julien Matin-Delaporte, conseiller du roi, receveur des
finances à Montélimar, qui dut soutenir divers procès concernant ses droits et ne profita guère
de ses biens.
Propriétaires de leur terre, dépourvus de seigneur et privilégiés par toutes leurs libertés
liées à la montagne, les Marsannais avaient, moins que d'autres, de doléances à exprimer.
Ils en avaient pourtant, car la majorité des exploitations étaient petites, les récoltes
souvent désastreuses à cause des intempéries et des violences dévastatrices des nombreux
torrents. Les exigences royales devenaient de plus en plus pesantes et le contrôle des récoltes
de plus en plus serré. C'est ainsi qu'on devait "déclarer les bleds, au-delà de la quantité
nécessaire à sa subsistance, sous peine de confiscation totale" (Inventaire Lacroix, Marsanne
E. 1709). Il était interdit "sur peine de vie" de faire passer les grains d'une province à l'autre.
Interdite aussi la plantation de vigne, sous peine de trois mille livres d'amende, pour favoriser
la culture des céréales insuffisante au plan national (Inventaire Lacroix, Marsanne E. 1729)
Que dire de la lourdeur des impôts ? Outre la taille assise arbitrairement sur les biens
possédés, et qui atteignait pour la communauté plus de 4 500 livres en 1788, il fallait payer la
dîme au clergé, soit un dixième des grains et vins récoltés.
En 1761, cela représentait :
144 setiers = 85 hl de bled
93,5 setiers = 55,25 hl de seigle
15 setiers = 8 hl d'orge
104 setiers = 61 hl d'épeautre
45 setiers = 26,5 hl de blé noir
(sarrasin)
35 charges = 2 813,6 litres de vin
Sur le montant de cette dîme, on prélevait la vingt-quatrième partie appelée couramment "la
vingt-quatrième", réservée aux pauvres dont la liste établie annuellement comptait 71
personnes en 1789 (Arch. Mun.)
Il fallait en outre effectuer la corvée royale, ensemble de travaux dû au Roi. Travaux
d'entretien ou de construction des routes, des ponts et chemins. Travaux pénibles et lourds,
exigés à n'importe quelle époque de l'année et privant souvent l'agriculture de bras. Alors les
doléances portèrent essentiellement sur la suppression de la corvée, la libre circulation des
grains, l'ajustement des impôts, ou l'aide en cas de mauvaises récoltes.
La Révolution
Pas de traces des activités marsannaises aux toutes premières semaines de la
Révolution, mais le 11 mars 1790, conformément au décret du 14 décembre 1789, la vieille
communauté devenue Commune ouvre le premier registre des délibérations municipales pour