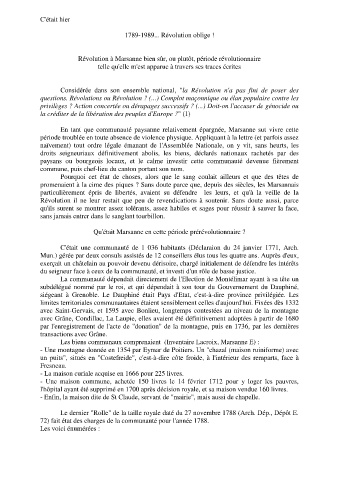Page 104 - Tous les bulletins de l'association des" Amis du Vieux Marsanne"
P. 104
C'était hier
1789-1989... Révolution oblige !
Révolution à Marsanne bien sûr, ou plutôt, période révolutionnaire
telle qu'elle m'est apparue à travers ses traces écrites
Considérée dans son ensemble national, "la Révolution n'a pas fini de poser des
questions. Révolutions ou Révolution ? (...) Complot maçonnique ou élan populaire contre les
privilèges ? Action concertée ou dérapages successifs ? (...) Doit-on l'accuser de génocide ou
la créditer de la libération des peuples d'Europe ?" (1)
En tant que communauté paysanne relativement épargnée, Marsanne sut vivre cette
période troublée en toute absence de violence physique. Appliquant à la lettre (et parfois assez
naïvement) tout ordre légale émanant de l'Assemblée Nationale, on y vit, sans heurts, les
droits seigneuriaux définitivement abolis, les biens, déclarés nationaux rachetés par des
paysans ou bourgeois locaux, et le calme investir cette communauté devenue fièrement
commune, puis chef-lieu du canton portant son nom.
Pourquoi cet état de choses, alors que le sang coulait ailleurs et que des têtes de
promenaient à la cime des piques ? Sans doute parce que, depuis des siècles, les Marsannais
particulièrement épris de libertés, avaient su défendre les leurs, et qu'à la veille de la
Révolution il ne leur restait que peu de revendications à soutenir. Sans doute aussi, parce
qu'ils surent se montrer assez tolérants, assez habiles et sages pour réussir à sauver la face,
sans jamais entrer dans le sanglant tourbillon.
Qu'était Marsanne en cette période prérévolutionnaire ?
C'était une communauté de 1 036 habitants (Déclaraion du 24 janvier 1771, Arch.
Mun.) gérée par deux consuls assistés de 12 conseillers élus tous les quatre ans. Auprès d'eux,
exerçait un châtelain au pouvoir devenu dérisoire, chargé initialement de défendre les intérêts
du seigneur face à ceux de la communauté, et investi d'un rôle de basse justice.
La communauté dépendait directement de l'Election de Montélimar ayant à sa tête un
subdélégué nommé par le roi, et qui dépendait à son tour du Gouvernement du Dauphiné,
siégeant à Grenoble. Le Dauphiné était Pays d'Etat, c'est-à-dire province privilégiée. Les
limites territoriales communautaires étaient sensiblement celles d'aujourd'hui. Fixées dès 1332
avec Saint-Gervais, et 1595 avec Bonlieu, longtemps contestées au niveau de la montagne
avec Grâne, Condillac, La Laupie, elles avaient été définitivement adoptées à partir de 1680
par l'enregistrement de l'acte de "donation" de la montagne, puis en 1736, par les dernières
transactions avec Grâne.
Les biens communaux comprenaient (Inventaire Lacroix, Marsanne E) :
- Une montagne donnée en 1354 par Eymar de Poitiers. Un "chazal (maison ruiniforme) avec
un puits", situés en "Costefreide", c'est-à-dire côte froide, à l'intérieur des remparts, face à
Fresneau.
- La maison curiale acquise en 1666 pour 225 livres.
- Une maison commune, achetée 150 livres le 14 février 1712 pour y loger les pauvres,
l'hôpital ayant été supprimé en 1700 après décision royale, et sa maison vendue 160 livres.
- Enfin, la maison dite de St Claude, servant de "mairie", mais aussi de chapelle.
Le dernier "Rolle" de la taille royale daté du 27 novembre 1788 (Arch. Dép., Dépôt E.
72) fait état des charges de la communauté pour l'année 1788.
Les voici énumérées :