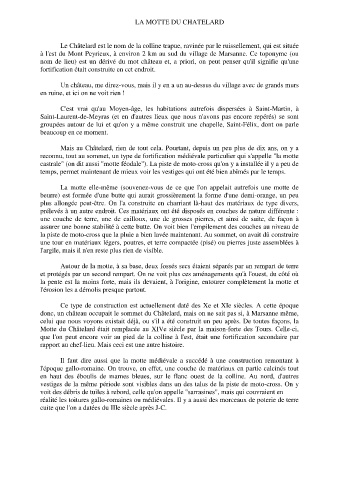Page 90 - Tous les bulletins de l'association des" Amis du Vieux Marsanne"
P. 90
LA MOTTE DU CHATELARD
Le Châtelard est le nom de la colline trapue, ravinée par le ruissellement, qui est située
à l'est du Mont Peyrieux, à environ 2 km au sud du village de Marsanne. Ce toponyme (ou
nom de lieu) est un dérivé du mot château et, a priori, on peut penser qu'il signifie qu'une
fortification était construite en cet endroit.
Un château, me direz-vous, mais il y en a un au-dessus du village avec de grands murs
en ruine, et ici on ne voit rien !
C'est vrai qu'au Moyen-âge, les habitations autrefois dispersées à Saint-Martin, à
Saint-Laurent-de-Meyras (et en d'autres lieux que nous n'avons pas encore repérés) se sont
groupées autour de lui et qu'on y a même construit une chapelle, Saint-Félix, dont on parle
beaucoup en ce moment.
Mais au Châtelard, rien de tout cela. Pourtant, depuis un peu plus de dix ans, on y a
reconnu, tout au sommet, un type de fortification médiévale particulier qui s'appelle "la motte
castrale" (on dit aussi "motte féodale"). La piste de moto-cross qu'on y a installée il y a peu de
temps, permet maintenant de mieux voir les vestiges qui ont été bien abîmés par le temps.
La motte elle-même (souvenez-vous de ce que l'on appelait autrefois une motte de
beurre) est formée d'une butte qui aurait grossièrement la forme d'une demi-orange, un peu
plus allongée peut-être. On l'a construite en charriant là-haut des matériaux de type divers,
prélevés à un autre endroit. Ces matériaux ont été disposés en couches de nature différente :
une couche de terre, une de cailloux, une de grosses pierres, et ainsi de suite, de façon à
assurer une bonne stabilité à cette butte. On voit bien l'empilement des couches au niveau de
la piste de moto-cross que la pluie a bien lavée maintenant. Au sommet, on avait dû construire
une tour en matériaux légers, poutres, et terre compactée (pisé) ou pierres juste assemblées à
l'argile, mais il n'en reste plus rien de visible.
Autour de la motte, à sa base, deux fossés secs étaient séparés par un rempart de terre
et protégés par un second rempart. On ne voit plus ces aménagements qu'à l'ouest, du côté où
la pente est la moins forte, mais ils devaient, à l'origine, entourer complètement la motte et
l'érosion les a démolis presque partout.
Ce type de construction est actuellement daté des Xe et XIe siècles. A cette époque
donc, un château occupait le sommet du Châtelard, mais on ne sait pas si, à Marsanne même,
celui que nous voyons existait déjà, ou s'il a été construit un peu après. De toutes façons, la
Motte du Châtelard était remplacée au XIVe siècle par la maison-forte des Tours. Celle-ci,
que l'on peut encore voir au pied de la colline à l'est, était une fortification secondaire par
rapport au chef-lieu. Mais ceci est une autre histoire.
Il faut dire aussi que la motte médiévale a succédé à une construction remontant à
l'époque gallo-romaine. On trouve, en effet, une couche de matériaux en partie calcinés tout
en haut des éboulis de marnes bleues, sur le flanc ouest de la colline. Au nord, d'autres
vestiges de la même période sont visibles dans un des talus de la piste de moto-cross. On y
voit des débris de tuiles à rebord, celle qu'on appelle "sarrasines", mais qui couvraient en
réalité les toitures gallo-romaines ou médiévales. Il y a aussi des morceaux de poterie de terre
cuite que l'on a datées du IIIe siècle après J-C.